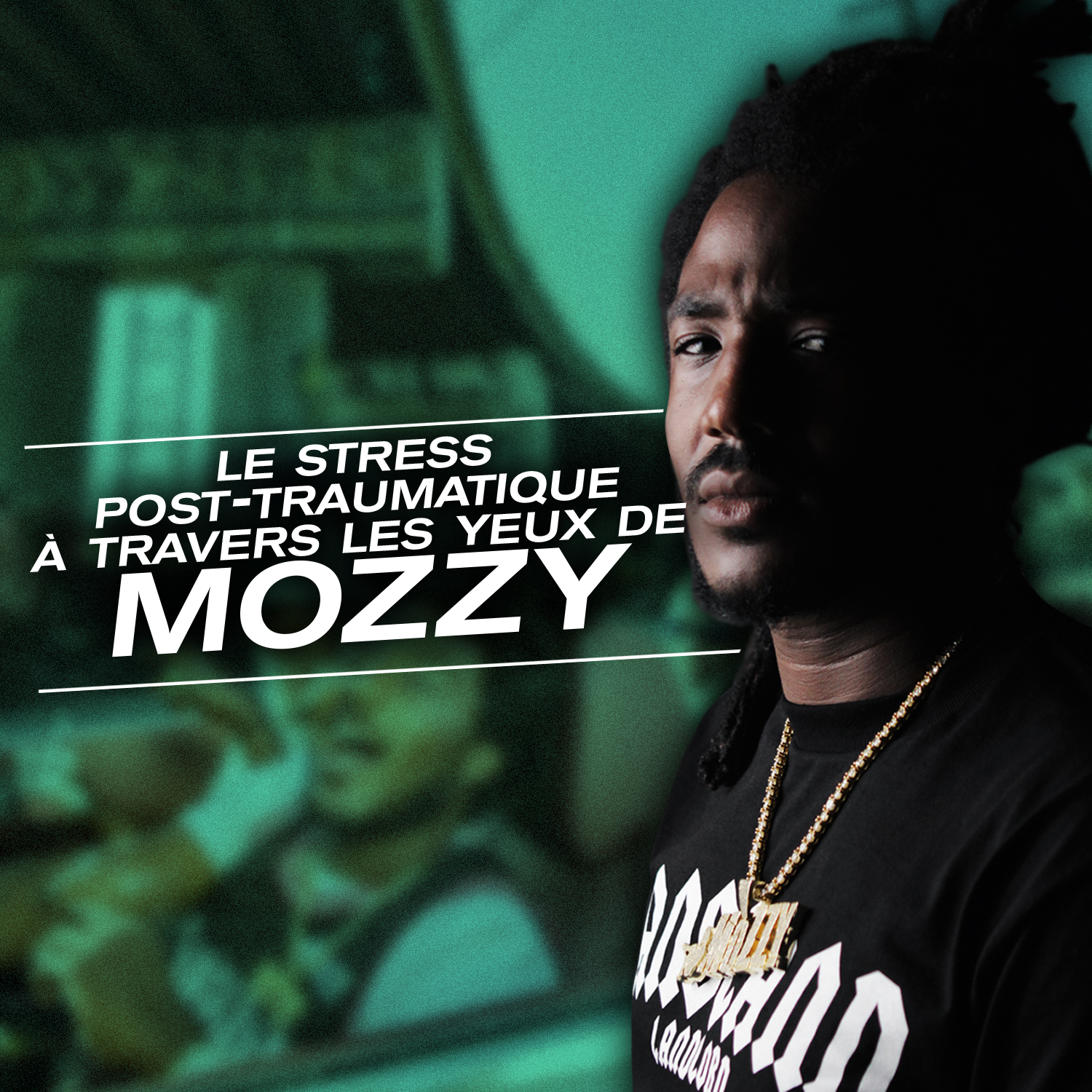Le stress post-traumatique à travers les yeux de Mozzy
Le stress post-traumatique est un ensemble de réactions qui peut se développer après avoir vécu un événement traumatisant. Si la définition tient sur un bout de papier, une expérience traumatisante cache de multiples cicatrices uniques pour tout à chacun. Un symptôme qui n’est donc pas à prendre à la légère tellement le poids à porter peut s’avérer colossal. De plus, avoir vécu une situation commotionnelle une fois dans sa vie est une chose, mais lorsque que celle-ci n’a fait que se reproduire année après année, mois après mois, la difficulté pour s’en extirper en devient presque impossible. Pour de nombreux rappeurs issus de classe précaire vivant dans des quartiers où la violence règne et l’aide médicale y est absente, il va de soi que certains choisissent l’art des mots comme échappatoire. On pourrait citer DMX est son ancienne vie de SDF, Chief Keef acteur de la violence à Chicago ou encore Kodak Black et ses allers-retours interminables derrière les barreaux. Dans cette caste, Mozzy s’y confond parfaitement. Ne pouvant raconter que ce qu’il commet et ce qu’il observe, le rappeur dépeint un environnement dépravé, des mares de sang à chaque coin de rue provoquées par des balles égarées dans des corps. Un choc cérébral qui mène à un flirt avec la colère et la dépression que le rappeur expose dans ses chansons par une franchise qui nous donnerait presque envie de le pardonner. Il faut alors trifouiller chaque aspect de sa personnalité, son enfance ainsi que sa ville, Sacramento, pour comprendre ses symptômes actuels. Un cobaye qui pourra nous en dire long sur l’âme écorchée de nos artistes favoris.

Né et élevé dans la périphérie
A première vue, la ville de Sacramento est tout ce qu’il y a de plus classique. De hauts buildings à l’effigie de banques puissantes, une université réputée, une Cour Suprême à l’architecture romaine et une rivière qui longe l’Ouest de la ville. Capitale de la Californie, les vieux avares venus trouver gloire au milieu du XIXe siècle lors de la ruée vers l’or auront permis à la ville de Sacramento de se développer après que les Espagnols eurent été expulsés par les Américains. Comme toute ville qui se doit d’évoluer, ce sont des quartiers qui pullulent tout autour de la métropole. Après la première et seconde guerre mondiale, les Afro-Américains, victimes de la ségrégation, seront logés dans la ville et notamment à Oak Park, première suburb à être bâtie pour y insérer une population précaire. Les palmiers humides plantés devant les habitations synonyme d’un soleil radieux et d’une vie paisible ne sont qu’illusion. Un encadré rouillé aux portes de la ville vient annoncer la bienvenue aux visiteurs aguerris. Celui-ci est transpercé par des balles formant des trous béants sur les inscriptions. Le parc, lui, n’a rien d’un terrain de jeu pour enfant, mais plutôt d’un terrain vague à l’herbe jaunâtre sans âme où seuls quelques arbres défleuris tirent un décor. Avec l’expansion des gangs de Bloods et de Crips dans Los Angeles au milieu des années 70, ce n’était qu’une question de temps pour que le phénomène s’empare de Sacramento, déjà composé de petits groupes de malfaiteurs comme Funk Lords. Pour couronner le tout, des communautés asiatiques et mexicaines s’immiscent dans la ville, rendant les violences encore plus évidentes. Seules des bannières jaunes de scène de crime ainsi que les fresques murales en l’honneur d’un frère décédé font office de décoration dans ce paysage terne. A ce jour, une gentrification s’effectue à Oak Park, dégageant les pauvres afin de les relocaliser dans une autre quartier pour que la boucle infinie se perpétue. Mais retournons en arrière à la période où Mozzy perdait ses dents de lait et que le quartier était encore un ghetto où il ne pleuvait que des balles.
Les boucles frisées prennent de l’altitude sur le crâne de Timothy Patterson pour former une coupe afro entourant son visage balafré. Le visage d’un enfant qui, dès qu’il aura côtoyé la lumière du jour, est remis à sa grand-mère, une gouru qui a frôlé la terre dans l’unique but d’éduquer Tim. Sa mère n’était pas capable d’élever un gosse aussi impertinent en vue de sa situation financière. Alors Timothy se façonne à une vie modeste choisissant la légalité en effectuant des jobs alimentaires. Mais grandir à Sacramento n’assure pas un avenir sans remous. Du haut de ses 12 ans, le garçon se frotte aux traditions des gangs, notamment celles des Bloods, ceux aux bandanas rouges, s’adonnant à des cambriolages et autres ventes de pilules bleues. Puis un nouvel artefact lui tombe dans les mains : un glock. Tout ce qu’il y a de plus banal dans les rues de Oak Park et dans l’Amérique en général. Sauf qu’on lui apprend à affectionner ce jouet, le garder toujours près de sa ceinture en cuir. Sa matière grise se formate à des images brutales où la gâchette est mise sous pression trop facilement. Les effets que provoquent les calibres n’ont plus rien d’effrayant pour le garçon. Les flaques de sang, qui s’étendent sur l’asphalte brulé, sont devenues des trophées qu’il admire. Une jouissance s’en émane, car Tim a toujours idolâtré 2Pac ou Snoop Dogg vantard d’un mode de vie de gangster. Cela appartient à un aboutissement, ressembler à ses mentors et vivre avec allégresse grâce à des bénéfices illégaux.
Beretta dans la joie
Le sablier du temps s’écoule, grain après grain. A 16 ans, Timothy a déjà utilisé son beretta sans remords, sans faire tourner ses méninges avant d’appuyer sur la queue de détente. Cela lui vaudra d’être incarcéré dans la prison fédérale de Los Angeles de multiple fois. A côté de cela, il est introduit au rap par les grands d’Oak Park et se mettra à utiliser la langue de Shakespeare à sa sauce pour décrire chaque aspect foireux de sa vie. Un blaze classique en ressort : Lil Tim. Encore un visage de bébé mais une routine incompatible avec son jeune âge pour des récits époustouflants. Sa carrière s’oblige à une entracte après son arrestation en 2005 en possession d’armes à feu non déclarées. Quatre ans au trou à patienter qui résulte à un agrégat de frustration dans son métabolisme. Malgré cela, il sait qu’être derrière les barreaux est bien moins dangereux que de traîner dans les rues de sa ville. Deux ans après sa sortie en 2010, le morceau U ain’t Really Like Dat fait son apparition. Un titre qui prend de l’ampleur dans Sacramento pour venir rattraper le temps perdu, et où l’on ressent les prémisses d’un futur Mozzy. Sur une production sourde, presque inaudible, Lil Tim enchaîne bars après bars. Le rappeur s’accorde à mettre un point d’honneur sur la notion de franchise dans ses propos. Les tournures de phrase sont sublimées mais en aucun cas les faits sont falsifiés. La réalité qu’il expose n’est constituée que d’images qu’il a pu enregistrer depuis ses globes oculaires. N’ayant jamais quitté sa terre natale, la frontière de la Bay Area constitue son seul repère. Cela ne l’empêche pas Timothy a procédé à une réincarnation afin de devenir plus vrai que jamais en citant des faits toujours plus précis, n’hésitant pas à balancer des noms de mecs qui ont goûté au métal de son glock. Pour rendre les choses claires, il se rebaptise Mozzy, argot pour qualifier l’argent, le cheese, le guacamole. Pour son rite de passage parmi les grands de l’industrie musicale, il effectue une mixtape avec le producteur DJ Fresh, s’inscrivant dans la coutume des Tonight Show où ont pu défiler Freddie Gibbs, E-40 ou Mitchy Slick. Lil Tim renaît de ses cendres pour devenir un adulte accompli, prêt à rendre hommage aux fantômes qui rôdent dans la 4th Avenue et embrasser ses traumatismes passés pour les exorciser dans ses lyrics.
Loin de vouloir laisser son gang sur le bas côté, Mozzy embarque ses alliés sous son label Mozzy Foundation. Celly Ru, E Mozzy, Hus Mozzy sont tout aussi désespérés et rongés par le crime et la drogue que notre antagoniste. Alors ils s’égarent dans le monde du rap pour espérer trouver une porte de sortie. Il faut pourtant se rendre à l’évidence, la bande de lurons ne rencontre pas le succès escompté malgré une plâtrée de mixtapes au début de la décennie. Une traversée du désert qui n’est faite que de liqueur coulant sur le sol pour se remémorer les cadavres des homies disparus. Le rap qui devait faire office de thérapie pour Mozzy devient un nid à problème à force de citer des noms d’homme qu’il désire exterminer. En mars 2014, alors au côté de Philthy Rich sur I’m Just Bein Honest, Mozzy prononçait le nom de trop. “Lav never caught a body, I’m just bein honest” déclare notre rappeur pour affirmer que Lavish D. However n’aurait pas les épaules assez solides pour être un homme droit de sang-froid. Suite à ce chant, huit balles viennent trouver preneur quelques jours plus tard dans des drive-by, sans que nos deux rappeurs ne capitulent. En plus d’un argot chauvinisme, Mozzy règle ses affaires en musique. Si il subit la douleur d’une vie infernale, celui-ci ne peut s’empêcher de l’alimenter comme attiré par le danger. L’insomnie ne lui est pas inconnue, les envies suicidaires non plus. Il le sait, ses symptômes le suivront jusqu’à sa mort alors il n’y a aucune raison à ne pas reproduire le schéma de l’ auto-destruction chaque jour que Dieu fait.
Pèlerinage vers l’enfer
Pourtant, la spontanéité des rimes de Mozzy ainsi que sa voix granuleuse dépourvue de vocodeur séduit un certain public n’ayant d’yeux que pour le gangsta rap et la Mobb Music. Du tac au tac, le rappeur n’a d’autre choix que d’extérioriser sa peine engourdie. Sans honte, il dévoile ses séances d’ablations qui finissent par des pleurs, son cerveau secoué par ses démons. Une démonstration de son moi et de son ça, sans se préoccuper de son surmoi. “Crazy how the mainy shit i done keep on huntin’ me” déclare Mozzy dans Bladadah, premier projet à lui apporter un succès considérable. Sa franchise a payé, et ce n’est plus que de simples locaux qui s’identifient mais des auditeurs de l’Oregon jusqu’au Texas à présent. Cela est l’occasion de s’échapper du carcan dans lequel il s’est empêtré et enfin partir en tournée. Mais rattrapé par son passé, sa surveillance judiciaire l’empêche de mettre un pied en dehors de l’État de la Californie à compter de 2018. Un cercle vicieux où le passé ne peut être dissocié du présent. Déjà piégé de sa propre boîte crânienne, même les étendues au relief irrégulier des USA ne sont pas à sa portée. L’occasion pour lui de se concentrer en studio, des heures dans la booth, pour espérer extraire les maux qui le hantent. Ses journées continuent à être rythmées par le bruit sourd des tirs et, si Mozzy n’est pas d’humeur joviale, la ville devient pour lui un stand de tir de fête foraine. Un monstre qui pourtant nous envoûte, nous amadoues lorsqu’il crie sa peine. La preuve avec ses confessions dans son projet 1 Up Top Ahk en 2017, toujours sur des rythmes funk froid, où la bassline tombe à plat, seulement venue supporter la voix sinistre de notre homme. Une tournée est faite au sein de la Californie, encourant le risque de se faire transpercer le corps par un inconnu dans le public. Pour estomper l’hypothétique haine dans les salles de concert bondées, Mozzy se débarrasse de son accoutrement couleur sang pour revêtir un t-shirt noir.
En hommage au groupe Luniz d’Oakland - ville entraînée dans le tourbillon de la Mobb Music - un sample du refrain “I got 5 on it” résonne dans Not Impressive. Dans un contre-pied digne d’une belle ironie, Mozzy s’exprime avec un argot local à propos de ses mémoires sans prendre la peine de nous faire comprendre chacune des références. Pourtant le titre devient l’un des nombreuses hymnes du bonhomme. Maintenant, Mozzy se proclame comme étant le nouvel ambassadeur du Gangsta rap, digne héritier d’un 2Pac. Ganglord landlord est l’album venu confirmer son statut de leader à Sacramento. Il adoucit sa formule, se permet de faire appel à Ty Dolla $ign, Rexx Life Raj pour élargir son public. Ses 16 mesures sont entrecoupés de refrains mielleux adressés explicitement aux femmes. Là, Timothy joue un rôle, porte le masque de la bienveillance, s’adonne aux lois du marché. Or, la maladie n’en est pas plus guérie. L’espoir d’une une vie sereine est certes présent, mais ses affaires avec les crackheads ne peuvent s’évaporer d’un coup d’un seul. La preuve lorsqu’on le retrouve au côté de Gunplay pour une mixtape en commun. Un homme tout aussi meurtri et ruiné par l’abus de substances anesthésiques. Alors Mozzy adopte le syndrome du survivant, ne pouvant se résoudre à être encore sur cette terre. Impossible d’abandonner Oak Park comme le montre la pochette de son prochain album, Beyond Bulletproof : un cabriolet propulsé à toute allure sur une avenue, trois vétérans de la rue sur les sièges passagers, Mozzy qui tient le guidon la gueule au vent. Les marques laissées par le temps sont encore présentes dans cette oeuvre, mais Mozzy est lucide sur la folie de son monde.
Les thérapies auxquelles il s‘adonne face caméra sont une méthode de plus pour exorciser les derniers fragments de perversité. Année après année, le stress post-traumatique s’estompe, sans réellement disparaître, la faucheuse n’étant jamais bien loin. Sur sa rocking chair, Timothy bascule d’avant en arrière attendant la mort avec impatience. Aucune affection pour la vie ne le retient, alors il est destiné à perpétuer des 16 mesures jusqu’à en perdre la raison. Un syndrome de répétition, c’est-à-dire une bobine de de son propre film qui passe en boucle dans sa matière grise ne lui laissant plus que le choix de prendre à bras le corps ses névroses.
De cette narration, Mozzy est loin d’être le seul atteint. Tous victime de notre environnement, le déterminisme n’a jamais été autant d’actualité dans un monde où l’on sur-analyse l’être humain. Pourtant, quelle belle ironie de vouloir venir en aide à l’homme et sa cervelle complexe tout en rejetant celui qui ne ressemble pas au modèle imposé par la société. Alors Mozzy, comme beaucoup d’autres, rappeur ou non, acquiert plus de mériter que ceux disposés dès leur naissance dans des tours d’ivoire. Quand dans une existence la névrose domine, une certaine beauté s’en émane.